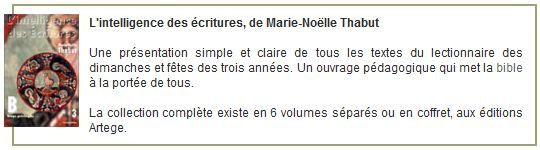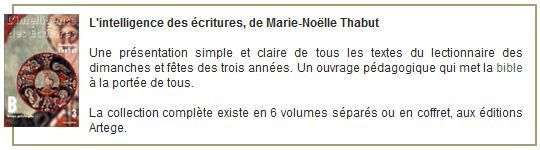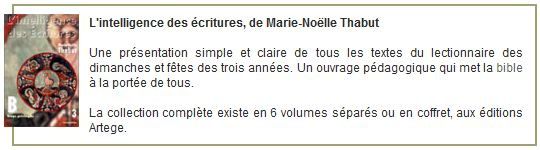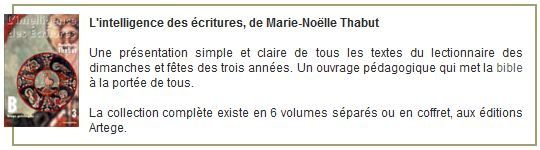PREMIÈRE LECTURE – Livre de la Sagesse 2, 12… 20
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes:
12 « Attirons le juste dans un piège,
car il nous contrarie,
il s’oppose à nos entreprises,
il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu
et nous accuse d’infidélités à notre éducation.
17 Voyons si ses paroles sont vraies,
regardons comment il en sortira.
18 Si le juste est fils de Dieu,
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires.
19 Soumettons-le à des outrages et à des tourments;
nous saurons ce que vaut sa douceur,
nous éprouverons sa patience.
20 Condamnons-le à une mort infâme,
puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »
RESTER FIDÈLES AU MILIEU DES PAÏENS
Pour comprendre ce texte difficile, il faut le replacer dans son contexte. Le livre de la Sagesse est très particulier à tous points de vue : d’abord il est le dernier écrit de l’Ancien Testament, trente ou cinquante ans seulement avant la naissance du Christ ; ensuite il a été écrit en Égypte et non sur la terre d’Israël comme la plupart des autres livres bibliques ; enfin, il est écrit en grec et non pas en hébreu ou en araméen.
Depuis les conquêtes d’Alexandre le Grand, vers 330 av.J.C., toute une colonie juive s’était implantée en Égypte, à Alexandrie, sur le delta du Nil. Ils jouissaient d’une totale liberté religieuse, ils avaient des lieux de prière reconnus dans leurs villages (ou leurs quartiers, s’ils habitaient en ville), et pouvaient donc parfaitement continuer à pratiquer leur religion et la transmettre à leurs enfants ; comme toute la région parlait grec, ils se sont mis eux aussi à parler en grec, certainement dès la deuxième génération ; c’est là que, pour qu’ils puissent comprendre les Écritures, la Bible a été traduite en grec pour donner ce que nous appelons la Bible des Septante.
Un certain nombre de Juifs d’Alexandrie sont donc restés très fidèles à la foi de leurs ancêtres ; mais c’était moins facile qu’on ne le pense : cette population avait une double appartenance, juive d’abord, mais aussi grecque puisqu’ils étaient immergés en milieu grec. Or les deux religions, juive et grecque, étaient totalement incompatibles. Pour un Juif plongé en milieu grec, l’intégration, comme on dit aujourd’hui, signifiait l’abandon de toutes ses pratiques. Il fallait donc choisir : ou décider de rester fidèle en tous points à la religion juive, au risque de s’isoler, ou s’intégrer à son nouveau pays au risque de s’éloigner de la communauté juive et d’abandonner l’une après l’autre toutes les pratiques juives. Il est bien évident qu’au sein même de la communauté juive, ces deux positions ont existé et ont engendré des conflits parfois très durs.
Ces conflits rendent la fidélité encore plus difficile ; parce qu’on sait bien que les querelles religieuses sont les plus terribles ! Or ceux qui gardent la foi sont un reproche vivant pour ceux qui l’abandonnent. Ils seront donc persécutés, non par les Grecs, très libéraux sur ce point, mais par leurs propres frères, qui n’ont pas trop bonne conscience et vont se venger sur eux. C’est classique : généralement, on n’aime pas les donneurs de leçons ! Quand on sait qu’on est en tort, on n’aime pas bien ceux qui nous le font remarquer.
Pour le voleur, l’homme honnête est un reproche vivant ; pour le violent, l’homme pacifique et doux est intolérable. Deux solutions : changer de conduite ou bien faire taire celui qui nous fait de l’ombre.
Le texte que nous lisons ce dimanche reflète exactement ce contexte : personne ne sait qui l’a écrit puisque le Livre de la Sagesse n’est pas signé. Mais visiblement, il s’agit d’un croyant qui assiste à l’érosion de la communauté juive, et qui veut encourager ses frères à rester fidèles. Il leur dit : il faut choisir : oui, la fidélité est difficile, d’abord parce que la loi juive est exigeante. Mais aussi parce que vous serez en butte à ceux qui ne feront pas comme vous et qui verront en vous des donneurs de leçons : « Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie… (il s’oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et) nous accuse d’infidélités à notre éducation. »
TENIR BON DANS LA PERSÉCUTION
Que fait un croyant fidèle quand il est ainsi exposé à la persécution de ses plus proches ? Il essaie de tenir le coup en s’appuyant sur sa foi et se disant « Dieu ne m’abandonnera pas ». Alors l’auteur ajoute : il y aura pire. Cette confiance que vous manifestez en Dieu quand vous dites « il est notre Père, il ne nous abandonnera pas ») … cette confiance même vous sera reprochée comme de la prétention. C’est exactement la suite du texte ; les persécuteurs disent : « Voyons si ses paroles sont vraies, regardons où il aboutira. Si ce Juste est fils de Dieu, (comme il le prétend), Dieu l’assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un veillera sur lui. »
Évidemment, on ne peut pas s’empêcher de penser que c’est exactement ce qui s’est passé pour Jésus-Christ. Sa conduite qui importunait… la haine grandissante de tous ceux qui voyaient en lui un donneur de leçons, un gêneur… les bonnes raisons de le supprimer : « il vaut mieux qu’un seul homme meure pour tout le peuple.. » dira Caïphe (Jn 11, 50). Mais le livre de la Sagesse ne parlait pas pour Jésus-Christ, il parlait pour ses contemporains dont il voulait encourager la fidélité, quel qu’en soit le prix. Il avait certainement en tête quelques exemples célèbres, à commencer par tous les prophètes. Ils ont tous eu à souffrir de leur franc parler.
L’exemple de Jérémie était particulièrement célèbre ; dans ce qu’on appelle ses « Confessions », il décrivait tout ce qu’il avait dû subir ; par exemple :
« Quel malheur, ma mère, que tu m’aies enfanté : moi qui suis, pour tout le pays, l’homme contesté et contredit… tous me maudissent. » (15, l0)…
…« À longueur de journée, on me tourne en ridicule, tous se moquent de moi… Je suis en butte, à longueur de journée, aux outrages et aux sarcasmes… J’entends les propos menaçants de la foule… Tous mes intimes guettent mes défaillances… » (20, 7-8).
Une fois même, il a entendu des menaces qui le concernaient sans qu’il le sache (« Détruisons l’arbre en pleine sève, supprimons-le du pays des vivants ; que son nom ne soit même plus mentionné ! ») mais il n’a pas compris tout de suite qu’il s’agissait de lui ; il raconte : « Quand le SEIGNEUR m’a mis au courant et que j’ai compris, alors j’ai découvert leurs manœuvres. Moi, j’étais comme un agneau docile, mené à la boucherie ; j’ignorais que leurs sinistres propos me concernaient. » (11, 18-19).
L’auteur du livre de la Sagesse fait probablement allusion à cette terrible expérience de Jérémie, mais ses lecteurs savent aussi le plus important, à savoir que Dieu n’a jamais abandonné aucun de ses prophètes et qu’il n’abandonne donc jamais ceux qui vont jusqu’au bout de leur foi. Dans les versets suivants, il affirme : « Quand les méchants font leurs raisonnements, ils se trompent : (leur perversité les aveugle)… ils ne connaissent pas les secrets desseins de Dieu. » Il ajoute : « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment ne les atteindra ». Sa conviction est telle qu’il va jusqu’à affirmer : même si vos ennemis réussissaient à vous tuer, eh bien, au-delà de la mort, Dieu ne nous abandonnera pas (chap. 3). Manière de dire : Tenez bon…(Le vrai bonheur est là.) La vraie Sagesse est dans la fidélité.
PSAUME – 53 (54), 3-4, 5, 6-8
3 Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
4 Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
5 Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
6 Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
8 De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
LE DOUBLE CRI DU CROYANT PERSÉCUTÉ
Dans la Bible, ce psaume est précédé de deux indications : l’une dit comment il doit être chanté, accompagné avec des instruments à cordes ; l’autre est beaucoup plus intéressante, parce qu’elle fait allusion à un épisode particulier de l’histoire d’Israël : « Quand les Zifites vinrent dire à Saül : David n’est-il pas caché parmi nous ? » David est en mauvaise posture : le roi Saül qui l’a d’abord traité comme son fils, a peu à peu sombré dans une jalousie féroce : tout réussissait trop bien à ce jeune qui serait bientôt son rival, si on ne s’en méfiait pas ; les choses vont si mal que David s’enfuit de la cour de Saül ; mais chaque fois qu’il se réfugie quelque part, il se trouve quelqu’un pour le dénoncer. Dans l’épisode en question, David est caché dans les montagnes de Judée, près d’un village qui s’appelle Ziph et des habitants vont le dénoncer au roi Saül. David n’a aucun espoir d’en réchapper si Dieu ne s’en mêle pas.
On imagine très bien que sa prière a dû ressembler à ce psaume, c’est-à-dire le double cri du croyant persécuté : le premier cri, c’est le cri d’appel dans la détresse, (appel qui peut aller jusqu’au souhait de voir la mort des ennemis) ; le deuxième cri c’est le cri de la victoire parce que Dieu ne peut manquer de venir au secours de son fidèle.
En fait, quand un psaume donne une indication de ce genre, il ne prétend pas que ce texte tel quel est sorti de la bouche ou de la plume de David ; mais que le peuple d’Israël tout entier a connu des situations analogues à celle de David. À plusieurs reprises, au cours de son histoire, il a été menacé de la destruction totale. Au moment de l’Exil, par exemple, tout portait à croire que ce petit peuple serait bientôt rayé de la carte du monde : à vues humaines, cela ne faisait aucun doute. Et alors il a poussé ce double cri : l’appel au secours, d’abord : « Par ton Nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance, rends-moi justice » ; dire « Par ton NOM sauve-moi », c’est invoquer l’Alliance de Dieu : car c’est précisément là, dans l’Alliance, au Sinaï, que Dieu a révélé son NOM à son peuple. C’est vraiment l’argument le plus fort de sa prière : la fidélité de Dieu à son propre choix, à sa promesse. C’est Dieu qui a choisi ce petit peuple, qui a envoyé Moïse à sa tête pour le libérer et qui, ensuite, a proposé son Alliance ; tous seuls, on n’y aurait pas pensé.
David non plus, n’avait rien demandé ; c’est Dieu qui avait envoyé le prophète Samuel choisir David parmi tous les fils de Jessé et l’avait fait envoyer à la cour du roi Saül pour qu’il se prépare à être roi plus tard. Lui, David, n’aurait jamais eu tout seul une idée pareille. Raison de plus pour prendre Dieu au mot. C’est pour cela qu’il invoque la puissance de Dieu « Par ta puissance, Dieu, rends-moi justice » … manière de dire « c’est toi, le roi suprême, qui m’as choisi comme roi ».
Le deuxième accent de la prière, c’est déjà l’action de grâce, comme dans toute prière juive, parce que, à tout instant, on a la certitude d’être exaucé. Quand Jésus, dans sa prière, disait à son Père « je sais que tu m’exauces toujours » (Jn 11), il était bien l’héritier de la foi de son peuple. Du coup, le psalmiste, que ce soit David, ou que ce soit le peuple tout entier, prévoit déjà la cérémonie d’action de grâce : « De grand cœur je t’offrirai le sacrifice » (le mot traduit ici par « de grand cœur » signifie « magnifiquement, royalement »). Il parle au futur, et non pas au conditionnel, parce que sa délivrance est certaine.
Mais il y a aussi dans cette prière du croyant des accents de vengeance, des paroles de haine, il faut bien l’admettre : au moment même où celui qui prie reconnaît que son Dieu est avec lui, il le prie de le débarrasser des autres ! « Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. » Et il ajoute « Que le mal retombe sur ceux qui me guettent ; par ta vérité, Seigneur, détruis-les. »
ON PEUT TOUT DIRE À DIEU
Nous rencontrons assez souvent des paroles de ce genre dans les psaumes ; on en trouve aussi jusque chez les prophètes, par exemple Jérémie ! Lui aussi a fait des prières de ce genre : à propos du livre de la Sagesse, nous avons évoqué des extraits de ses Confessions dans lesquels il se plaint d’être ridiculisé, menacé, persécuté ; mais il y a aussi parfois dans ses prières, tout grand prophète qu’il est, des accents nettement vengeurs : « SEIGNEUR tout-puissant, toi qui gouvernes avec justice, qui examines sentiments et pensées, je verrai ta revanche sur eux, car c’est à toi que je remets ma cause. » (Jr 11, 20)… « SEIGNEUR, venge-moi de mes persécuteurs. Que je ne sois pas victime de ta patience envers eux… » (Jr 15, 15)… « Qu’ils soient couverts de honte, mes persécuteurs et non pas moi ; qu’ils soient accablés, eux, et non pas moi ! Fais venir sur eux le jour du malheur, brise-les à coups redoublés ! » (Jr 17, 18).
Ce genre de violences verbales nous choque tellement que nous avons tendance à les censurer. Mais au nom de quoi pouvons-nous nous permettre de censurer les Écritures ? D’où une première leçon : il n’y a pas que de pieux sentiments dans les psaumes, c’est-à-dire dans les prières qui nous sont proposées ; cela veut dire que nous n’avons pas à travestir nos sentiments devant Dieu. Montrons-nous tels que nous sommes, c’est lui qui nous convertira.
Cela veut dire aussi que nous savons que Dieu est engagé avec nous, à nos côtés, dans la lutte contre tout ce qui ravage l’homme. Que le Mal est son ennemi. « Que le mal retombe sur ceux qui me guettent », c’est exactement la prière de David poursuivi par Saül : plusieurs fois, David a été tenté de se venger et s’y est refusé ; mais c’est peut-être bien parce qu’il s’en remettait à Dieu du soin de régler ses comptes à ses ennemis, en particulier à Saül, que David a trouvé la force, bien des fois, de ne pas se venger.
Une prière de ce genre (« Que le mal retombe sur ceux qui me guettent ») reflète donc déjà un progrès de la conscience morale du peuple de Dieu : on a appris à ne pas se venger soi-même et à s’en remettre à Dieu. Lui qui est LA Justice, ne manquera pas de « faire justice ». C’est déjà une étape très importante dans la pédagogie biblique.
Il restera à découvrir que la vengeance dans la haine n’est pas la bonne façon de recouvrer sa dignité et que le pardon nous grandit bien davantage. Jésus, lui, et à sa suite, Etienne, pardonneront à leurs bourreaux et prieront pour eux.
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » ; c’est la prière de celui qui est l’amour parfait, ce n’est pas encore la nôtre, spontanément.
Alors, quand nous rencontrons des phrases de ce genre dans les psaumes, nous sommes invités à nous faire une âme de frères : il y a à chaque instant à la surface de la terre des hommes et des femmes qui n’ont pas d’autre ressource que la haine et la soif de vengeance pour garder leur dignité ; disons cette prière avec eux pour qu’ils résistent à la tentation de se venger par eux-mêmes. Et nous puiserons peut-être là le courage de les secourir. Et puis, rien ne nous empêche d’ajouter, en leur nom, la prière du Christ en croix « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
DEUXIÈME LECTURE – Lettre de saint Jacques 3,16-4,3
Bien-aimés,
3, 16 la jalousie et les rivalités mènent au désordre
et à toutes sortes d’actions malfaisantes.
17 Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut
est d’abord pure,
puis pacifique, bienveillante, conciliante,
pleine de miséricorde et féconde en bons fruits,
sans parti pris, sans hypocrisie.
18 C’est dans la paix qu’est semée la justice,
qui donne son fruit aux artisans de la paix.
4, 1 D’où viennent les guerres,
d’où viennent les conflits entre vous ?
N’est-ce pas justement de tous ces désirs
qui mènent leur combat en vous-mêmes ?
2 Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien,
alors vous tuez ;
vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins,
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre.
3 Vous n’obtenez rien
parce que vous ne demandez pas ;
vous demandez, mais vous ne recevez rien ;
en effet, vos demandes sont mauvaises :
puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
LES DEUX VOIES
Nous rencontrons souvent dans la Bible le thème des « deux voies » : le voici sous la plume de saint Jacques, cette fois. D’un côté, jalousie, rivalités, conflits et guerres ; de l’autre, paix, bienveillance, justice, miséricorde ; ce sont deux modes de vie qui s’opposent, deux « sagesses » au sens de « savoir-vivre ». Plus haut, Jacques a parlé d’une « sagesse terrestre, animale, démoniaque » (3, 15) ; ici, il parle de l’autre sagesse, celle qui vient de Dieu ; la première est la vie à la manière d’Adam, l’autre, celle vers laquelle nous devons tendre, celle de Jésus, le doux et humble de cœur.
Voilà pourquoi ce texte multiplie les oppositions : elles se ramènent toutes à une seule, l’opposition entre les deux sagesses, les deux comportements.
Par exemple, « la jalousie et les rivalités » (v. 16) sont à comprendre par contraste avec ce qui est dit au verset suivant : « paix, tolérance, compréhension » ; et les « actions malfaisantes », par contraste là encore avec les « bienfaits » du verset 17.
Qui est visé au juste ici ? Jacques ne nous le dit pas, mais il n’avait probablement pas besoin de préciser davantage pour être compris.
D’après les thèmes abordés dans le reste de la lettre, on peut émettre quelques hypothèses: les jalousies et rivalités pouvaient être d’ordre matériel ou d’ordre spirituel ; pour les conflits d’ordre matériel, il suffit de se rappeler tout le développement précédent sur les discriminations sociales entre riches et pauvres (2, 1-5 ; cf. 23e dimanche) ; sans parler de la mise en garde adressée un peu plus loin aux riches (5, 1-6 ; cf. 26e dimanche).
Pour les conflits d’ordre spirituel, il est intéressant de noter au passage que le mot traduit ici par « jalousie » peut évoquer le fanatisme des idées. Il faut relire les versets qui précèdent juste notre lecture de ce dimanche : au début de ce chapitre 3, Jacques met en garde les fidèles contre ce qu’on pourrait appeler les « méfaits de la langue » : « La langue est un petit membre et se vante de grands effets… Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père ; avec elle aussi nous maudissons les hommes, qui sont à l’image de Dieu ; de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. » (3, 5… 10). Un peu plus loin, il est encore plus clair : « Si vous avez le cœur plein d’aigre jalousie et d’esprit de rivalité, ne faites pas les avantageux et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. » (3, 14). Le risque ne devait pas être seulement hypothétique puisqu’il l’a évoqué dès le premier chapitre : « Si quelqu’un se croit religieux sans tenir sa langue en bride… vaine est sa religion. » (1, 26).
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VIVRE
Pour Jacques, tous ces comportements de jalousie et de rivalité relèvent du paganisme ; la vraie religion, qu’elle soit juive ou chrétienne, nous introduit à une tout autre manière de vivre. Les mêmes réalités (qu’elles soient d’ordre matériel ou spirituel) peuvent être vécues d’une manière ou de l’autre. Il n’y a pas un bonheur païen et un bonheur chrétien, il y a deux manières de vivre le bonheur, la manière païenne et la manière chrétienne. Jusqu’ici, nous étions sous le règne de la convoitise, c’est-à-dire de l’égoïsme ; la religion juive et, à plus forte raison, le Christianisme, nous introduisent dans le royaume de l’amour fraternel. C’était tout le sens du commandement « Tu ne convoiteras pas » : non pas « tu ne désireras plus rien », mais premièrement, tu n’accapareras pas pour toi seul, deuxièmement, tu ne te laisseras pas accaparer. Si tu deviens esclave de ce que tu possèdes, tu perds ta liberté (puisque tu es obsédé par ton désir) et tu perds la charité parce que tu deviens envieux de ce que l’autre possède.
Pourtant, la Bible n’enseigne nulle part le mépris des biens de ce monde : depuis la première parole de Dieu à Abraham, au contraire, le peuple élu sait que Dieu ne veut que notre bonheur, dont le bien-être matériel fait partie. Et le désir du bonheur, matériel ou spirituel, est bon, puisqu’il fait partie de la création. Il nous faut seulement apprendre à nous remettre sans cesse dans la main de Dieu : un peu plus loin, Jacques dit ce que doit être notre état d’esprit : « Si le Seigneur le veut bien, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » (4, 15).
« Si le Seigneur le veut bien », c’est la formule de Jacques, toute proche de celle de Jésus : « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Mais, pour nous, le passage d’une sagesse à l’autre n’est jamais totalement achevé : nous sommes des êtres partagés ; Jacques dit qu’un véritable combat se déroule en nous-mêmes et que nos querelles n’en sont que le reflet : « D’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-mêmes ? »
Le secret est dans la prière, car Dieu seul peut donner la sagesse : c’est l’une des grandes insistances de toute la méditation biblique ; dès le début de sa lettre, Jacques conseillait à ses lecteurs de prier pour l’obtenir : « Si la sagesse fait défaut à l’un de vous, qu’il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche ; elle lui sera donnée. » (1, 5).
ÉVANGILE – selon saint Marc 9, 30 – 37
30 En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples,
et il ne voulait pas qu’on le sache,
31 car il enseignait ses disciples en leur disant:
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ;
ils le tueront
et, trois jours après sa mort, il ressuscitera »
32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles
et ils avaient peur de l’interroger.
33 Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? »
34 Ils se taisaient,
car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand.
35 S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit :
« Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
36 Prenant alors un enfant,
il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit :
37 « Quiconque accueille en mon nom
un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille
Ce n’est pas moi qu’il accueille,
mais Celui qui m’a envoyé. »
LES PENSÉES DE DIEU NE SONT PAS NOS PENSÉES
« Les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur d’interroger Jésus » nous dit Marc …
On les comprend ! Pourtant, ce n’est pas la première fois que Jésus annonce de tels événements ; puisqu’au chapitre précédent, dans le même évangile de Marc, après la fameuse profession de foi de Pierre à Césarée, Jésus a déjà dit exactement la même chose ; mais ce n’est toujours pas clair ! Pour les disciples, c’est même incroyable, choquant, contradictoire.
Pourquoi ? Parce que ses paroles sont totalement contraires à l’idée qu’ils se font de Dieu et totalement contraires à l’idée qu’ils se font du Fils de l’homme.
Et pour les trois privilégiés qui ont été témoins de la Transfiguration de Jésus (dans l’évangile de Marc, la Transfiguration est placée au début de ce même chapitre 9), c’est peut-être encore plus scandaleux, invraisemblable. Ils sont encore dans la lumière, dans l’éblouissement de la Transfiguration… Jésus a été déclaré le Fils bien-aimé, celui qu’il faut écouter… et voilà qu’il annonce pour lui-même les plus grandes humiliations ; il les présente comme certaines, inéluctables.
Même si tous n’ont pas été témoins de la Transfiguration, tous ont entendu la profession de foi de Pierre : « Tu es le Messie », c’est-à-dire celui que Dieu a choisi pour sauver son peuple, pour régner sur son peuple. Dans l’évangile de Marc, Jésus ne répond guère à Pierre, il ne fait pas de commentaire, mais il est clair qu’il lui donne raison, puisqu’il ordonne à ses disciples de garder le secret là-dessus pour l’instant. « Jésus leur demandait : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Prenant la parole, Pierre lui répond : Tu es le Christ. Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne ».
Et tout de suite après, il dit ces choses étonnantes : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis à mort et que, trois jours après, il ressuscite. » Nous sommes au paroxysme de la contradiction : lui qui vient d’être dit le Bien-aimé de Dieu, il est l’élu de Dieu, le Messie, le roi qu’on attend, le Fils de l’homme : tout cela lui promet un destin glorieux ; puisque dans les visions du prophète Daniel (Dn 7, 13-14), le Fils de l’homme est celui qui doit prendre la tête de toute l’humanité ; et pourtant Jésus dit qu’il doit affronter la souffrance et la haine des hommes, en un mot, la croix. Or dans la tête des disciples, comme dans celle de tous leurs contemporains d’ailleurs (et peut-être bien dans la nôtre), la gloire et la croix ne font pas bon ménage !
Autre contradiction, ou invraisemblance : dans un premier temps, il va être livré, tué, réduit à l’état d’objet passif de la haine des hommes. Celui qui doit prendre la tête de toute l’humanité sera traité comme le rebut ! Et puis, dans un deuxième temps, il ressuscitera, il triomphera ! Le dernier sera devenu le premier. Non seulement, la gloire et la croix sont inséparables, mais il semble bien que la gloire passe par la croix !
LE MONDE À L’ENVERS
C’est le monde à l’envers : pas étonnant que les disciples ne soient pas spontanément au diapason ! Car « nos vues ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes », comme l’a dit Jésus à Pierre (8, 33). Plus tard, seulement, les disciples comprendront « qu’il fallait » que le Christ aille jusque-là pour « glorifier » son Père, c’est-à-dire révéler son amour. Pour l’instant, ils n’ont pas du tout envie d’être derniers ! Au contraire, juste après ces paroles troublantes de Jésus, ils se sont mis à discuter entre eux pour savoir lequel d’entre eux était le plus grand ! Ils sont dans une problématique de rivalité, celle dont saint Jacques parlait dans la deuxième lecture. Chose curieuse, Jésus n’a pas l’air horrifié : il ne leur dit pas « c’est mal de vouloir être premier », il leur donne même le moyen d’y arriver. Décidément, on va d’étonnement en étonnement dans ce texte.
Le moyen, d’après lui, est bien simple et ce qui est intéressant, c’est qu’il est à la portée de tout le monde ! « Celui qui veut être le premier, qu’il se fasse le dernier et le serviteur de tous ». Dans le chapitre suivant du même évangile de Marc, on retrouvera à peu près le même déroulement : annonce de la Passion du Christ, rivalité entre les disciples pour la première place et réponse de Jésus : « Si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. Et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est venu non pour être servi mais pour servir … » On ne peut pas s’empêcher de faire le rapprochement avec le récit du lavement des pieds dans l’évangile de Jean.
Ici, Jésus prend un exemple qui effectivement est à la portée de tout le monde : il prend un enfant, le place au milieu d’eux et l’embrasse : ce geste, de la part de Jésus, est certainement très significatif ; à l’époque, l’enfant n’était pas « l’enfant-roi » comme on dit aujourd’hui ! En embrassant un enfant, Jésus embrasse la petitesse. C’est tout un programme. Puis il leur dit : « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même »… On croit entendre la fameuse parabole du Jugement Dernier dans l’évangile de Matthieu : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Jésus précise bien « si vous le faites en mon nom ». C’est là probablement le secret de la véritable grandeur aux yeux de Dieu : ce ne sont pas les actions en elles-mêmes qui sont grandes ! C’est de les faire au nom de Jésus-Christ.
Voilà encore une bonne nouvelle : parce que cela aussi est à la portée de tout le monde !
——————————-
Complément
« Celui qui accueille en mon nom… Et celui qui m’accueille, ne m’accueille pas moi, mais Celui qui m’a envoyé » : Parole ferme et rassurante à la fois : vous voulez sincèrement être mes disciples, accueillir le salut de Dieu dans vos vies, je vous en indique le chemin… (rassurant) – il n’y en a pas d’autre (ferme).
commenter cet article …